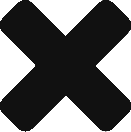par Leïla Larabi Touati

La réalisatrice Shirley Clarke a tourné ce film radical durant la nuit du 2 décembre 1966. Au travers du portrait insaisissable de Jason Holliday, malgré les rires et la fausse légèreté qui traversent tout le film, la cinéaste montre l’Amérique des années 60, l’horreur du passif entre les noirs et les blancs, mais aussi les limites de ce que peut faire le cinéma.
Tourné en pellicule avec des bobines qui ne peuvent enregistrer que 10 minutes de film avant d’être renouvelées, le film est une suite de longs plans séquences durant lesquels Jason raconte des anecdotes de sa vie, parfois commandée par son compagnon, Carl Lee, qui se trouve hors-champ. Et quel conteur ! Comme lors d’une performance de Jazz, Jason improvise des solos en jouant de son être, comme d’un instrument duquel il aurait une parfaite maîtrise : sa gestuelle de danseur, sa voix chaleureuse et profonde, son sourire enchanteur, son articulation verbale parfaite font de lui une personne terriblement séduisante ! Pourtant, cette manière qu’il a de s’effondrer sur le canapé après chaque histoire, avec une gravité lancinante qui semble reprendre sa place sur son visage, en dit long sur la mascarade qu’il nous donne à voir. Shirley Clarke fait en sorte de perdre le point à ces instants-là et Jason, devenant alors très flou, semble pouvoir retourner avec pudeur à sa douloureuse solitude.
Car de la même manière que pour les artistes de Jazz des années 60, la grâce de leur expression n’est finalement qu’une suppléance devant l’horreur d’une condition politique monstrueuse : déracinés de force de leurs terres ancestrales africaines, définis par les scientifiques de l’époque comme des êtres sans âme, instrumentalisés comme des bêtes de somme puis ségrégés comme des parias, les afro-américains doivent redoubler de génie pour trouver leur place dans la société américaine. Mais cela ne peut pas se faire sans troubles pathologiques criants, et pour les noirs et pour les blancs ! Et c’est à cet endroit que la cinéaste dépasse la position victimaire, pour considérer le rapport noir/blanc dans sa folie existentielle : c’est devenu une sorte de jeu de rôle sado-masochiste qui s’alterne et qu’on peut entendre dans ce film, en crescendo, de manière de plus en plus insupportable : Jason raconte comment il se prostituait pour des hommes blancs et en quoi “les baiser” lui redonnait un sentiment de domination, de revanche, malgré sa position sacrificielle. Puis des insultes sont échangées entre Carl et Jason, toujours entre deux éclats de rires, mais qui maintenant évoquent une certaine démence.
Le cinéma dispose de deux formes qui permettent de donner un caractère d’authenticité à un film: le plan séquence (qui en limitant les coupes au montage donne un sentiment de vérité) et l’improvisation de l’acteur (qui donne un surplus de vitalité au personnage). Ici, Shirley Clarke montre Jason qui se raconte, en totale improvisation dans de longs plans séquences et pourtant, le spectateur peut sentir à quel point on ne le cerne pas. Malgré ses confidences et le débordement de ses émotions, Jason reste une surface opaque, impénétrable, fuyante. Parce qu’au fond l’être humain échappe à la représentation ; parce qu’il y a de l’inconscient ; parce que la raison d’être intime d’un individu n’a pas d’image. Il y a de l’impossible à dire une quelconque vérité qui pourrait arrêter la définition de ce qu’est une personne, car comme ici pour Jason il restera toujours un mystère fondamental. Et c’est ce point de butée, qui est une limite de l’expression cinématographique, qui est aussi montré dans ce film. Hitchcock disait : “Ce qui intéresse l’homme c’est l’homme” et toute l’histoire de l’art rivalise de talents pour tenter d’en dire quelque chose, même si c’est un puit sans fond… Mais on peut se réjouir de cette impasse finalement, puisque c’est cette quête philosophique et esthétique, vaine mais sublimement créative, qui motive la production infinie d’œuvres d’art et ceci jusqu’à la nuit des temps.