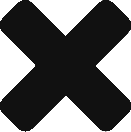inds of kindness est le dernier film du réalisateur grec Yourgos Lanthinos, sorti au cinéma en 2024. Connu pour ces mises en scène baroques et surréalistes, avec des œuvres telles que The Lobster ou Poor Things, Lanthinos propose ici une esthétique plus sobre à première vue… sans doute pour mieux laisser surgir une monstruosité qui se situe du côté de l’invisible de la pulsion.
Ce film, dont on pourrait traduire le titre par “toutes sortes de gentillesse” se présente sous la forme d’un triptyque : trois récits sans continuité narrative. La première histoire montre un salarié, Robert, qui laisse toutes les décisions de sa vie à son patron, Raymond, à qui il obéit sans sourciller pour le choix de ses repas, de ses vêtements, jusqu’à provoquer les fausses-couches de sa femme pour répondre au commandement de ne pas avoir d’enfant. Dans le second récit, Daniel est un officier de police qui après un passage à l’acte délirant est coincé chez lui, sous neuroleptiques, avec sa femme, Liz, qu’il peine reconnaitre. Leur relation de couple est très cordiale même quand il lui demande de préparer son pouce avec du chou cuisiné à la poêle pour le déjeuner. Liz obéit gentiment à toutes les demandes de son mari, jusqu’à s’éventrer pour lui préparer son propre foi, organe riche en protéines dont il a besoin. Enfin, le troisième volet du film, met en scène Emily qui est membre d’une secte dans laquelle les adeptes boivent les larmes de leur gourou : une femme capable de ramener les morts à la vie. Alors qu’Emily rend visite à sa fille chez son ex-mari, ce dernier – qui a pourtant l’attitude du parfait père de famille, à la fois tendre et responsable – met une drogue dans son verre pour la violer alors qu’elle est inconsciente.
Contrairement à la promesse du titre, ce film est un cauchemar et déploie surtout toutes sortes de méchanceté. Sans compter l’atmosphère d’inquiétant familier, au sens de Freud Die Unheimlichkeit, qui s’installe tout du long et qui est le résultat d’un contraste radical entre ce qu’on entend et ce qu’on voit ; à savoir des dialogues entre protagonistes d’une parfaite bienveillance versus la férocité de leurs actes. Passages à l’acte qui engagent toujours le corps (de l’autre ou le sien propre) et qui pourraient faire échos à cette proposition de Lacan : “les gentils, c’est la chrétienté, et chacun sait que la chrétienté comme telle est dans un rapport notoire avec les difficultés de l’érotique.”1 La bienséance, conduite sociale en accord avec les usages et qui permet la juste distance avec autrui, est constamment de mise dans les diverses situations du film ; mais finit par produire masochisme, viol, automutilation, cannibalisme… autrement dit, une sorte d’érotisme sadien.
Ici on peut souligner que les discours des personnages sont dénués de fantaisie ou d’humour et semblent témoigner d’une perte totale de la position de sujet des individus. Yourgos Lanthinos souhaite-t-il nous montrer l’avènement d’un nouvel être humain GPTisé ? Un humain post-moderne qui parlerait toujours d’une manière correcte, polie, non discutable et sans affect ? Un humain qui s’évertuerait à n’être que pur symbolique ? “Le monde du symbolique, c’est le monde de la machine”2 affirme Lacan. Pour une société utopique dans laquelle l’individu, oublieux de son corps vivant et de la condition de mortel qui l’accompagne, pourrait vivre sans souffrance certes mais sans joie ni plaisir non plus. On pourrait s’essayer à cette purification des rapports intersubjectifs au travail, avec ses amis et jusque dans son foyer à la maison. C’est déjà ce à quoi nous invite les réseaux sociaux avec le brouillage des frontières entre les sphères du public, du privé et de l’intime. Il faudrait toujours “bien dire” quelles que soient les personnes en présence.
Mais puisque le réel de la pulsion, inhérente au vivant, n’est pas négociable, c’est un plus-de-jouir aveugle qui sera au commande avec toutes les sortes d’abus et de malheurs que cela peut impliquer. Sachant que l’antidote est aussi du côté du symbolique, puisque la parole peut permettre de faire barrage aux passages à l’acte. Quand les individus retrouvent le chemin de la formidable plasticité de la langue, de sa vitalité qui repose sur le fait de pouvoir se tordre, s’inventer, se remanier à l’infini. Et aussi quand parfois, avec ses proches (ou sur le divan), on s’autorise à “dire du sale” comme disent les jeunes !
- Lacan J., L’identification, Leçon XIII du 14 mars 1962, Les Séminaires (1952 – 1978), p. 176
- Lacan J., Le Moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, Le Séminaires, livre II, p. 63